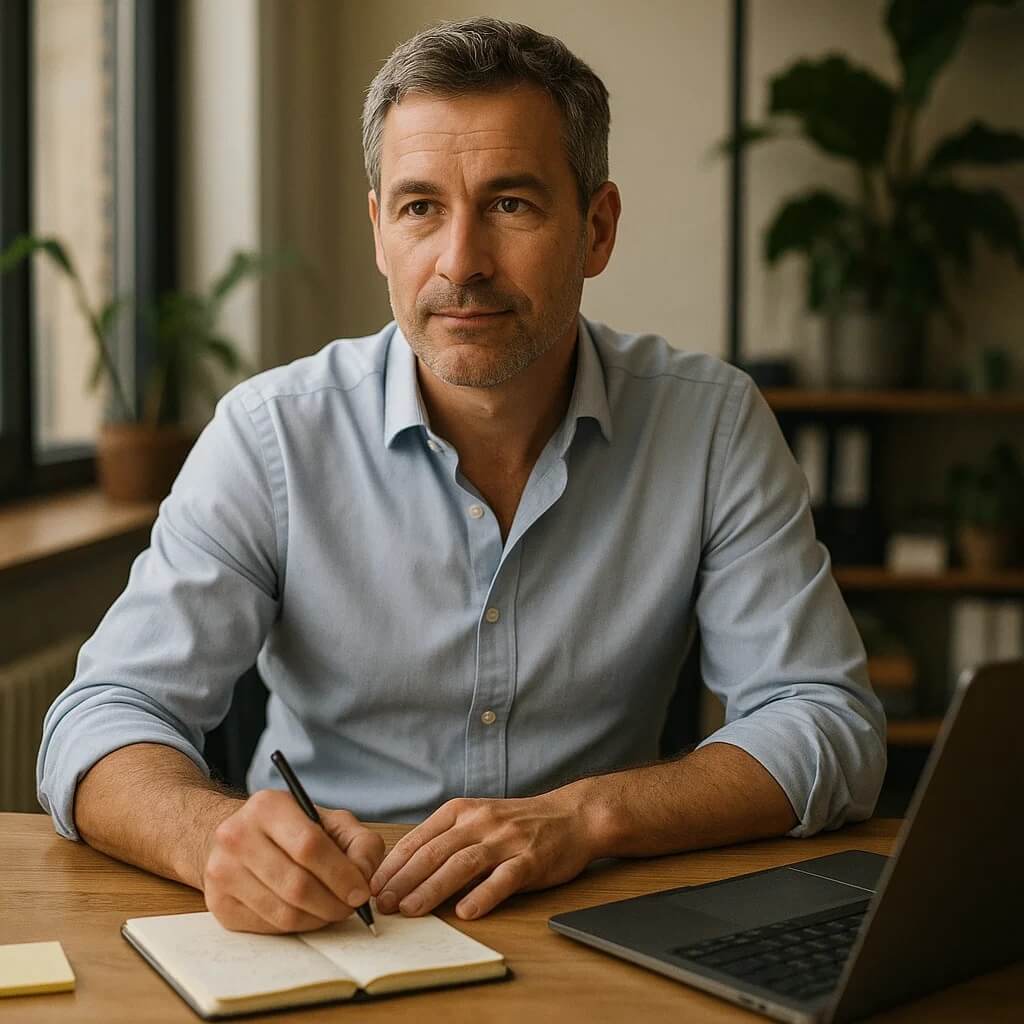En matière de risques cyber, les dirigeants d’entreprise ne peuvent plus se permettre d’ignorer leurs obligations juridiques. Voici un aperçu des principales dispositions légales et réglementaires.
Code Pénal :
En cas de négligence ou de manquement grave, un dirigeant peut être poursuivi pénalement, sur le fondement de l’article 223-1 (mise en danger de la vie d’autrui) , 121-3 (négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité) ou 323-1 (atteinte à un système automatisé de données) si une cyberattaque, par exemple, compromet la sécurité des employés, clients ou partenaires.
Code Civil:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art 1240). Or « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers (…) des fautes commises dans sa gestion » (art 1850 pour les SCI, L 225-251 pour les SA, L 223-22 pour les SARL)
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) :
Entré en vigueur en mai 2018, le RGPD impose aux entreprises de garantir la protection des données personnelles qu’elles collectent et traitent elles-mêmes ou dont elles confient une partie du traitement à leurs sous-traitants : obligation de privacy by design et de tenue de registre des traitements. En cas de manquement, les sanctions peuvent atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel, selon le montant le plus élevé.
Le dirigeant est directement responsable de la mise en œuvre de mesures techniques adaptées et de la déclaration sous 72 heures de toute violation de données à l’autorité de contrôle (en France, la CNIL) et aux personnes concernées.
NIS2 (Directive sur la Sécurité des Réseaux et de l’Information) :
Entrée en vigueur en janvier 2023, cette directive européenne impose, en particulier pour les secteurs critiques (santé, finance, énergie) un certain nombre de mesures:
- Réalisation d’audits réguliers des systèmes de sécurité.
- Mise en place de plans de gestion des incidents et de reprise d’activité.
- Sensibilisation et formation des équipes, y compris au niveau des cadres dirigeants.
- Transmission sous 24 heures d’un rapport aux autorités compétentes en cas de cyberincident majeur.
- Sanctions : jusqu’à 7 millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires pour les entités importantes et 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires pour les entités essentielles.